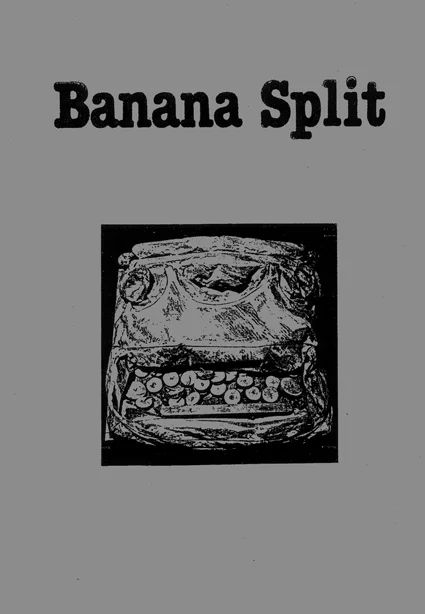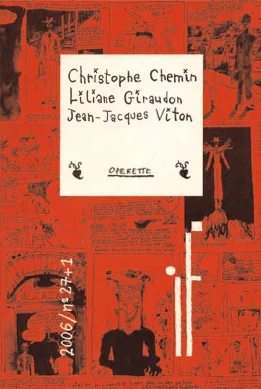Profession Revuiste
Bernard Plasse : Ce n’est pas avec Les Cahiers du Sud que vous avez inauguré votre trajectoire « revues », Jean-Jacques Viton ?
Jean-Jacques Viton : En effet, je n’ai pas commencé par Les Cahiers … J’ai ouvert la trajectoire avec Action Poétique, dirigée déjà par Henri Deluy. C’était 1958, j’avais fait la connaissance de Gérald Neveu, sans lequel je n’aurais peut-être pas rencontré les écrivains qui sont devenus mes amis, avec Henri Deluy, Joseph Julien Guglielmi et Jean Todrani, et ne serais peut-être pas monté au quatrième étage du 10 cours d’Estienne d’Orves où Jean Ballard avait établi les locaux des Cahiers du Sud et où j‘ai connu Jean Tortel, Raymond Jean, Gérard Arseguel, Jean Malrieu… C’est dans la Librairie Laffitte, alors située vers le haut de la Canebière et une fois par semaine ouverte jusqu’à 22h00, que j’ai rencontré Gérald Neveu. Un minuscule square, triste jardinet nanti d’une balançoire, existe à Marseille, dans le 9e arrondissement je crois, et porte son nom on se demande par quel hasard… Gérald Neveu, énigmatique et solaire, dont les Cahiers recevaient irrégulièrement la visite et comme avec une certaine méfiance. Il était sans emploi, pensionné des PTT, grand amateur de vin rosé, un beau visage à la Eluard mais en plus volontaire, il dégageait une rage contenue, parlait bas avec exactitude, les poches de sa veste étaient bourrées de petits livres et de poèmes en cours, il était classé comme “queue de comète surréaliste” et on trouvait aux Cahiers du Sud que sa fréquentation était un peu délicate… Jamais, à ma connaissance, les Cahiers n’ont sérieusement aidé Gérald Neveu en lui proposant une collaboration suivie, lui qui dans son errance précaire écrivait sans cesse, une collaboration dont à son point de solitude et de dénuement il aurait eu besoin ne serait ce que pour respirer. Je trouve lamentable que l’on trouve si peu trace de ce poète dans les sommaires des Cahiers… Restent deux ou trois livres publiés après sa mort…
BP : … Dont un Seghers, dans la collection Poètes d’aujourd’hui, réalisé par Jean Malrieu
JJV : C’est exact. Avec cette librairie, point de départ de ma relation avec les poètes de la ville, je voudrais citer aussi un bar qui devenait bar de nuit à partir de 19h00. Il s’appelait Le Longchamp, place de l’Opéra. Il a été remplacé longtemps par une discothèque, boite à façade noire. J’y ai fait la connaissance d’Axel Toursky, Axel, et c’est souvent en sa compagnie que je choisissais de rester au Longchamp plutôt que d’accompagner Gérard Arseguel et Joseph Julien Guglielmi qui, chaque mercredi vers 17h00 entraient là où nous avions rendez-vous pour, après un verre ou deux, y aller, aux Cahiers… J’hésitais pourtant toujours : allais-je cette fois-ci encore préférer la chaleur des whiskies, l’excitation des petites amies, l’ouverture de la nuit et le dîner tardif dans un restaurant du quartier, aux conversations un peu convenues et aux commentaires un peu retenus sur nos lectures respectives dans ce bureau des Cahiers où, après avoir ouvert la lourde porte en bois, Jean Ballard, costume croisé, cigarette aux lèvres, sourcils hérissés, tout droit jailli d’un film de René Clair, nous conduirait, précédé d’un vigoureux “voilà la jeune équipe !”, jusqu’à Marcou Ballard assise derrière une petite table prisonnière d’une pesante Remington, puis à Jean Lartigue au sourire chaleureux et enfin à Jean Tortel qui, impatient derrière ses lunettes, nous voyait venir… J’allais aux Cahiers du Sud de 1960 à 1966, deux fois sur quatre, ce rythme était hygiénique, il indiquait la distances que j’entendais conserver face à une équipe qui n’était pas vraiment la mienne et il était stratégique aussi car il me permettait de conserver ma place parmi les jeunes poètes qui avaient leurs entrées dans cette grande revue et y étaient parfois publiés. Comment comparer mon appartenance aux diverses revues auxquelles j’ai participé ou que j’ai cofondées et ma fréquentation des Cahiers du Sud ? Dans Action Poétique, au début du circuit, puis dans Manteia et ensuite, avec Liliane, dans Banana Split, IF, La Nouvelle BS, j‘étais plongé dans une dynamique d’avancée, une attention poétique, idéologique, les sommaires à construire étaient notre respiration d’écriture tandis qu’aux Cahiers je me sentais visiteur, prêt à recevoir des éclats de souvenirs de Valéry, Gaillard, Brauquier, Eluard, Saint John Perse sur ses sables, Bousquet dans sa chambre… je ne me risquais qu’à choisir sous le crayon comptable de Ballard parmi les livres du Service de Presse exposés sur un présentoir pour transformer vite mes futures lectures en de studieuses “notes de lectures” dont les Cahiers étaient affamés pour leurs échanges éditoriaux… Comment ne pas être un peu interloqué, là haut dans ce grenier qui relevait d’un décor de Strindberg, par ce quelque chose d’un peu convenu où l’admiration déclarée pour certaines écritures n’étaient pas toujours appréciée, par exemple pour les poètes italiens du groupe Novissimi (Edoardo Sanguineti, Nanni Balestrini, Elio Pagliarani, Antonio Porta… qui, sous l’insistance que nous avons imposée, avec Arseguel et Guglielmi, ont réussi a paraître à un sommaire prestigieux), ou les français Maurice Roche, Jean-Pierre Faye du groupe Change ou Marcelin Pleynet, Philippe Sollers, Denis Roche du groupe Tel Quel (ces ”littérateurs” disait Saint John Perse…). Et qui donc aurions-nous dû admirer davantage à cette époque et dans ces circonstances de remise en question radicale de l’écriture ? Je demeurais donc en frontière, il y avait ceux des Cahiers et il y avait nous. Je les trouvais eux moins audacieux que nous. Le seul poète déjà reconnu auquel nous pouvions parler de nos textes était Jean Tortel, ami de Francis Ponge, ce qui ne faisait pas beaucoup de monde au regard des autres revues… Quant à Toursky, grand ami de Tortel, il s’y rendait bien rarement et finit même par en être exclu, cas unique dans l’histoire des Cahiers du Sud !
Liliane Giraudon : C’est pourtant grâce à Axel Toursky que durant la guerre les Cahiers du Sud ont pu se procurer le papier nécessaire à leur publication. Parmi tous les figurants de cette époque, Toursky, dont il ne reste dans la mémoire de cette ville qu’un nom de théâtre, était sans doute l’un des personnages les plus énigmatiques. La première fois que je l’ai vu, c’était, moi aussi, dans un bar de nuit. Je lisais. Il s’est approché de moi et m’a demandé ironiquement, me sembla-t-il, ce que je lisais. J’ai répondu agressivement “Bataille !”, je lisais Le bleu du ciel, il m’a répondu avec un superbe sourire attristé : “Mademoiselle, j’espère pour vous que c’est Henri !”… C’était magnifique. Tout le dandysme ravageur de Toursky était là, dans cette répartie, une nuit, dans un bar de Marseille. Plus tard je l’ai revu à Avignon, chez les Tortel. Mais dans Banana Split nous n’avons publié un choix de poèmes et une de ses lettres à Jean Tortel qu’après sa mort.
BP : J’ai fréquenté Toursky au moment où il mettait la dernière main à Un drôle d’air. Il m’avait dit que la poésie souriante était plus difficile à exprimer. Et le livre en question était particulièrement mélancolique, voire noir. Mais jamais il n’en avait cité un seul extrait.
LG : Ce n’était pas encore l’époque des lectures publiques qui semblaient n’exister qu’en URSS et aux USA…
JJV : … Et je ne sais pas si Axel a même jamais lu un poème de lui en public… Nous en avons fait pas mal Liliane et moi… une lecture de poésie s’apparente à l’exposition d’un fragment, d’un détail tendu à l’attention, sinon à l’analyse, d’un public réuni dans ces musées provisoires en quoi sont transformées pour la circonstance les librairies concernées, espaces souvent choisis pour ces accrochages de la voix… Mais une lecture en public c’est aussi une manière d’exercice de tir, et comme pour toutes les démonstrations, il s’agit là d’adresse c’est-à-dire d’un contrôle de la trajectoire.
LG : Mais quel que soit le poète qui lit et quel que soit le fragment projeté, ne nous trompons pas : un poème lu en public ne fera jamais ni le bruit ni les dégâts d’une roquette artisanale destinée à pulvériser le sommet !
BP : Bigre ! ces lectures, peut-être moins bruyantes, n’ont-elles pas un double emploi avec les revues et ne cachent-elles pas l’ensemble derrière des détails fussent-ils explosifs ?… En un mot, pourquoi quand on est poète faire des revues de poésie ?
JJV : Peut-être une dépendance, une sorte d’intoxication mais tout de même pas une manie… Je constate que toutes ces dernières années se sont construites en circulant dans des infrastructures de revues. Il y a des écrivains qui disent que le temps consacré à une revue est du temps plombé quant au travail d’écriture, j’ai entendu ça… c’est un moteur du comportement qui aide justement chez un écrivain à entretenir une curiosité, à maintenir ou inventer une discipline et j’ai l’impression que je bouge mieux lorsque je suis entraîné de cette manière. Ce qui demeure fondamental dans ce travail de revue c’est la fréquentation textuelle d’auteurs nouveaux et le travail de traduction. Le texte étranger fait lire autrement sa propre littérature et permet de travailler mieux à l’intérieur de sa propre langue comme un étranger. C’est nécessaire et ça provoque des découvertes et un désir d’écriture. Il m’arrive souvent de m’arrêter dans un travail et de lire quelques pages, un ou deux passages d’un auteur étranger, prose, poésie, essai, catalogue… c’est une décharge et une recharge…
BP : … D’où ce besoin de plier un instrument à sa propre conception d’écriture et un enrichissement par des regards neufs ?
Couverture de Banana Split
LG : Lorsque nous avons décidé de créer la revue Banana Split nous avons en même temps programmé son existence éditoriale sur une seule décennie. Les 27 numéros sont parus entre Février 1980 et Décembre 1990 et nous continuons à penser qu’une revue doit avoir une trajectoire brève, si possible brillante, une manière d’étoile filante… Banana Split a proposé un esprit de fabrication nouveau : interventions libres et directes des auteurs invités dans la mise en page de leurs travaux sur des cadres spéciaux mis à leur disposition (ces fameux faire-part encadrés de noir et ensuite photocopiés) et où apparaissaient aussi l’adresse de l’auteur de manière à ce qu’un contact entre auteurs et lecteurs soit immédiatement possible. Nous avons eu le souci du cosmopolite où le résolument contemporain restait inséparable de la redécouverte d’un texte ancien. Banana Split a été une revue de poèmes, de textes, de traductions (plus de 15 albums étrangers), d’entretiens, d’interventions d’artistes (26 plasticiens) et de musiciens. Et c’est par provocation que cette revue du mélange et de l’extraterritorialité avait pris pour titre le nom stupide de ce dessert internationalement connu…
BP : Comment est apparue la revue IF ?
Couverture d'IF n° 1. 1992.
JJV : La revue IF a été créée en 1992 par des écrivains qui ont un certain goût pour les revues puisqu’ils en ont inventé plusieurs, en ont traversé quelques unes et continuent à en fabriquer : Action Poétique, Les Cahiers du Sud, Manteia, Banana Split, Impressions du Sud, La Nouvelle BS, Irrégulomadaire... Dans IF il y a le nom du bois dont on faisait les arcs et la badine avec laquelle on corrigeait les élèves ignares, l’adverbe du conditionnel anglais et le nom du célèbre château au fond duquel les prisonniers écrivaient sur les murs. On peut voir là un véritable programme sur lequel rêver. Et sur la 4e de couverture, une carte marine bouge comme un feu et glisse sur son propre espace d’un numéro à l’autre, signalant ainsi un mouvement incessant, celui de la littérature, celui des revues qui se battent contre l’opacité du monde, tentent de traverser en parlant contre cette opacité, résistent à un enfermement et font passer des messages codés, pas toujours déchiffrés. Cette carte donne à voir ce qui est dessous le tracé. Dedans. Au fond. Pour naviguer en surface une connaissance des fonds est indispensable. Fabriquer une revue c’est apprendre à naviguer et à tenir une cargaison à flot. Le programme de IF est aussi éclairé par la liste des auteurs publiés, bien souvent étrangers. En effet là aussi une grande part est faite encore une fois à la traduction. La lecture de Mina Loy ou de Victor Sosnora, totalement occultés en France, comme celle de Marina Tsvétaïeva ou d’Emily Dickinson, d’Oscar Pastior, de Gertrude Stein ou de Barbara Guest, d’Adilia Lopès ou de Christine Lavant, semble directement concerner les écritures “extrême contemporain” d’auteurs aussi différents que Katy Molnar ou Philippe Beck.
Couverture d'IF n° 27 + 1. 2006.
LG : Transmission. Translation. Transporter quelque chose d’un lieu à un autre, dans un certain ordre et selon une périodicité fixe. Deux numéros par an, un tirage de 600 exemplaires par numéro. Dans les cales de IF la cargaison semestrielle poursuit sa navigation, transporte de la langue stockée, vers ou prose, avec la même consigne : pas un seul voyage sans étranger. IF est un lieu pour lequel et dans lequel une distance est prise et maintenue par rapport à l’environnement de réflexion théorique et de tentative de modernité. Le nombre réduit d’écrivains à son comité de rédaction (trois personnes) est un choix, dans chaque numéro chacun insuffle ce qu’il veut faire apparaître de son approche de la littérature telle qu’elle se fait. “Chaque auteur contemporain doit trouver son sens intérieur de la contemporanéité”, cette réflexion de Gertrude Stein apporte une excellente dynamique à la construction des sommaires de IF. Programmée elle aussi sur un temps fixe compris entre le numéro 1 et le numéro 27, en imitation de Banana Split* cette revue IF a trahi ce programme et a poursuivi ses parution par un numéro 27 + 1 (soit 28 !) qui, à travers une BD de Christophe Chemin mettait en planches un roman inédit de LG et JJV, Le rasoir de Borgès. Un plan de partenariat est alors passé avec Hubert Colas codirecteur du Centre Montévidéo pour une parution partagée une fois par an mettant en pages une partie du programme actOral de Montevideo. C’est actuellement la vitesse de parcours de IF.
BP : Cette année, “1968” est célébré en France. La revue Manteia, créée en 1967, rencontre effectivement cet épisode…
JJV : J’en parle dans un livre collectif qui vient de sortir aux Editions Argol, Ecrire Mai 68, qui rassemble trente cinq écrivains invités par Catherine Flohic. Liliane Giraudon aussi témoigne dans ce livre en s’interrogeant sur l’effacement des katangais, l’absence quasi-totale de documents les concernant. Mais oui, bien sûr, Manteia traverse l’histoire elle aussi… Nous n’étions pas également unis au comité de rédaction, c’est le moins que je puisse dire… Arseguel et Guglielmi, anciens membres du PCF me reprochaient mon appartenance au Parti en 1958, mon travail de chroniqueur de théâtre à La Marseillaise le quotidien communiste de Marseille et mes articles sur le Festival d’Avignon où j’ai vu Vilar bassement insulté, Béjart fustigé et Julian Beck, dont j’admirais le Living Theater, crier “libérez les spectateurs !” en secouant les grilles du cloître des Carmes… Todrani restait le libertaire qu’il était redevenu, profondément, après un temps au PCF interrompu par les évènements tragiques de Budapest en 1956, quant à Charles Grivel, universitaire helvétique, il affichait une adhésion républicaine sérieuse sans alliance réelle. Je ne croyais pas trop à l‘ampleur politique “68”, je m’attendais à une réaction forte de De Gaulle. Je me disais que le PCF et quelques milliers d’ouvriers entourés par quelques milliers de jeunes étudiants et lycéens ne feraient jamais reculer les blindés de Massu et le PCF ne possédait plus les structures “militaires” qu’il avait à la Libération, il préparait Grenelle et ne voulait à aucun prix un affrontement frontal qu’il redoutait. J’avais quitté Action Poétique en 1965, j’ai quitté Manteia en 1974. Dans le même temps j’ai quitté aussi d’autres personnes et d’autres lieux, le PCF, la CGT, le journalisme, des groupes littéraires et politiques.
LG : Il est clair que si nous nous étions rencontrés à cette époque nous aurions eu peu de chance de collaborer… Mon goût pour les libertaires ne t’aurait certainement pas convenu… En fait quand on s’est rencontrés tu sortais d’une “diète” bénéfique : quitter les groupes, les partis, les appartenances a toujours quelque chose de vital, ça nettoie la tête !
* Banana Split était située à Aix-en-Provence au 27 Bd. du Roi René et a publié 27 numéros, à Marseille au 27 Av. du Prado et aurait du s’arrêter au n°27 puisque nous voulions respecter cette “loi du 27”… On sait que depuis Picabia il existe un lien entre revues et chiffres.